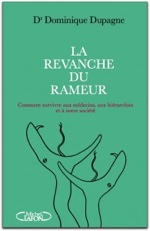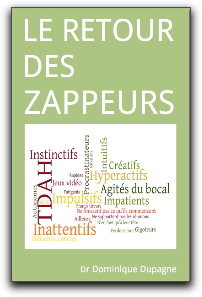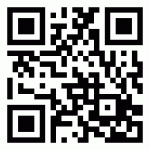Catégorie : Médecine

By Katsukawa Shunshō. Public domain
La première fois que je vois Pierre, c’est dans mon cabinet.
Il est un ancien patient du Dr Pouêt-Pouêt, un généraliste qui exerçait encore il y a quelque semaine dans un village voisin.
Pour entrer dans mon cabinet, Pierre ne peut pas le faire de face, il doit rentrer de biais.
C’est que Pierre est obèse
Beaucoup.
Médicalement, on dirait « Obésité morbide ».
En fait je sais que Pierre a 27 ans, mais je ne sais pas combien il pèse.
Il est de ce genre de patients que je ne pèse jamais. Non pas que je n’ai pas envie de savoir mais que le cadran de ma balance ne dépasse pas les 150 kilos.
Et Pierre en fait bien plus.
Mais personne ne sait combien
Le Dr Pouêt-Pouêt a bien tenté l’expérience une fois, c’était en 2003.
La balance n’a pas survécu. Pierre en garde d’ailleurs un souvenir douloureux.
Pierre, est un homme timide, ayant peu de relations sociales. Son poids y est pour beaucoup.
Il est accompagné de sa mère.
Quand il s’assoit la première fois dans mon cabinet, c’est avec inquiétude que je regarde la chaise sur laquelle il est assis se déformer. Mais je ne dis rien, de peur de le vexer.
Pierre est venu me demander un bilan sanguin pour voir si tout va bien.
Le Dr Pouêt-Pouêt ne lui en a jamais demandé, et Pierre a peur de faire du diabète ou du cholestérol. Pierre est d’autant plus inquiet qu’il fait souvent des infections au niveau de ses jambes (Erysipèle, on appelle ça entre médecins)
Je suis assez d’accord pour lui prescrire un bilan biologique sanguin, avec en effet une recherche de diabète, son poids très élevé est un facteur de risque. (et je rajoute un bilan hormonal, on ne sait jamais, des fois que son obésité ait une cause médicale …)
Mais d’abord, je demande à Pierre de s’allonger sur mon divan d’examen, ce qu’il fait assez difficilement et de manière assez brutale.
Je me rappelle à ce moment précis que mon divan d’examen est n’est certifié que jusqu’à 140 kilos.
Apparemment ça tiens.
Je me félicite intérieurement d’avoir pris du matériel de bonne qualité.
Je prends la tension de Pierre (avec mon brassard « grande taille »)
Tension : 13,5/8
« C’est bien »
Je l’examine, je l’ausculte, mais je ne le pèse pas donc.
Je retourne à mon bureau, je note les quelques antécédents de Pierre, j’écris « poids 150+ » et j’inscris dans le dossier pour mes associés et mes remplaçants « attention ne pas peser, casse les balances »
Je lui prescris le bilan biologique.
Pierre et sa mère sortent de mon cabinet apparemment satisfaits.
—
Je reçois les résultats de Pierre trois jours plus tard.
Il n’a pas de diabète, pas de cholestérol, sa prise de sang ne révèle aucune anomalie.
Je suis assez étonné, mais content.
—
La mère de Pierre vient me voir quelques semaines plus tard pour son renouvellement de traitement (elle aussi est une ancienne patiente du Dr Pouêt-Pouêt)
Je ne vous parle pas de cette consultation, qui est d’une banalité affligeante … Sauf sa toute fin, quand elle me dit à propos de son fils : « Pierre vous aime beaucoup, vous êtes le seul médecin à ne pas lui avoir fait remarqué tout de suite qu’il était trop gros, et le seul à ne pas lui avoir crié dessus à propos de cela à la première consultation. Ça compte beaucoup, il sait bien qu’il a du poids à perdre mais quand on lui fait remarquer trop brutalement, ça le blesse. »
—
J’avoue, en entendant sa mère me dire cela, j’ai eu un peu honte d’avoir eu peur pour mon matériel.
Mais quand même, il ne me serait jamais venu à l’esprit de dire, à la première consultation, « oh mais que vous êtes gros ! Il va falloir faire un régime là, parce que c’est plus possible, regardez-vous enfin ! »
Mais qu’est-ce qui passe par la tête de certains de mes collègues médecins ?
Alors oui, on va essayer de faire quelque chose pour le poids de Pierre.
Mais gentiment, en essayant de ne pas le vexer. Je pense qu’il a déjà eu sa dose …
 Robert est un nouveau patient.
Robert est un nouveau patient.
Il a 79 ans et une liste très très longue de maladies.
Et quand je dis une liste, je parle d’une vraie liste en papier avec des trucs écris au stylo dessus, que Robert transporte partout.
C’est d’ailleurs le principal sujet de notre première rencontre : recopier la liste de Robert dans son dossier, sur mon ordinateur
Robert, c’est le genre à faire des maladies et des complications.
Mais pas qu’un peu.
Quand il a toussé pendant deux jours avec un petit 38°, ça a fini en pneumonie.
Quand il a eu un peu mal à la vésicule, il a fini aux urgences avec un calcul coincé dans ses voies biliaires
Quand il a eu un peu mal aux côtes, là, ça a fini dans un service de chirurgie cardiaque pour un quadruple pontage.
Quand il a eu un peu mal au dos, ça a fini en sciatique hyperalgique.
Quand on l’a opéré de son dos, il a fini avec des séquelles fonctionnelles motrices.
Quand on lui a pris la tension un jour, on lui a trouvé 21/12.
Il ne fait jamais rien à moitié Robert. C’est écrit sur sa liste.
—
La deuxième fois que je vois Robert, nous sommes au mois de décembre, en pleine épidémie de gastro-entérite. Il vient me voir car il a un peu mal au ventre, des nausées et des selles liquides depuis deux jours.
Je l’examine, son ventre est souple, non douloureux. Il n’a aucun signe inquiétant. Pas de sang dans les selles, pas de grosse fièvre.
Rien, vraiment rien, qui puisse m’alarmer.
Je lui prescris donc quelques traitements symptomatiques, et le rassure quant à la bénignité de sa maladie.
Robert est très content, moi aussi.
Il rentre chez lui tranquillement
—
Je n’entends parler de Robert que trois semaines plus tard, quand je reçois un compte rendu d’hospitalisation en chirurgie.
Robert n’avait pas une gastro-entérite. Robert a fait une occlusion intestinale (pour les médecins : sur bride de sa cholécystectomie)
Robert est encore passé très près de la mort.
—
Robert est revenu me voir ensuite comme si de rien n’était, comme si c’était normal que je sois passé à côté de son occlusion intestinale.
Comme si en lisant sa liste, il était normal de ne pas se méfier, de ne pas réfléchir à deux fois.
Comme si je n’avais pas été un peu léger dans ma prise en charge.
Comme si je n’étais pas lamentablement passé à côté d’une urgence vitale.
Il m’a même sorti un « Je n’ai confiance qu’en vous docteur »
Les gens sont surprenants parfois.
Alors voilà, comme je ne peux pas te le dire en face, je te le dis ici :
Pardon Robert, vraiment. J’aurai dû savoir que tu ne fais jamais rien à moitié. C’est écrit pourtant sur ta liste.

Jacqueline est une petite dame blonde d’une cinquantaine d’années que je rencontre pendant les premières semaines de mon internat.
C’est l’une de mes toutes premières patientes dont j’ai la responsabilité pendant mon stage en Pneumologie. En fait, l’une des toutes premières patientes que je gère seul, avec les conseils avisés de mes chefs, mais seul.
Jacqueline n’est pas dans ce service pour rien.
Elle a un cancer du poumon. Le genre de cancer qu’elle a attrapé en fumant ses deux paquets de clopes par jour depuis ses 14 ans.
Elle vient régulièrement dans le service, pour ses séances de chimiothérapie et pour des bilans intermédiaires pour faire le point sur l’évolution de sa maladie.
Je l’aime bien Jacqueline. Elle m’est sympathique. On se voit tous les matins pendant son hospitalisation, pendant la « visite », on discute beaucoup, elle en a besoin.
Médicalement parlant, elle m’a tout fait Jacqueline.
La crise de panique dans le scanner.
L’aplasie fébrile post chimiothérapie.
La transfusion de plaquettes en urgences à 1h30 du matin (alors que j’étais de garde), avec son corollaire, le coup de téléphone à l’ophtalmo au milieu de la nuit pour vérifier que, oui oui oui elle saigne bien dans son oeil à cause de son manque de plaquette (Pardon gentil ophtalmo de t’avoir réveillé)
Le dossier d’assurance de dix pages détaillées à remplir en me demandant de pas trop insister sur son cancer. (Elle est gentille Jacqueline.)
La présentation de son dossier au staff devant un très grand professeur pour essayer de tenter un début de changement dans sa prise en charge.
Bref, je m’investis beaucoup dans la santé de Jacqueline.
Mais Jacqueline ne se rend pas bien compte qu’elle va bientôt mourir
Et moi je le sais, mais je ne veux pas y penser.
—
Un jour, je suis appelé au chevet de Jacqueline. Elle n’a pas fait de chimiothérapie récemment mais elle a de la fièvre et de forts maux de tête.
Elle a beaucoup maigri.
Il est 21h00 et je dois rentrer chez moi. Mais je n’ai pas envie de laisser le problème au médecin de garde.
J’essaie de faire au mieux. Je panique un peu, je n’ai pas envie de la laisser tomber.
Je lui prescris un peu plus de morphine pour la soulager et je lui demande un scanner cérébral en urgence, pour essayer de comprendre ce qui se passe. La négociation avec le radiologue de garde est difficile, mais j’arrive finalement à le convaincre.
Au moment où je dis aux infirmières que je descends Jacqueline dans le service de radiologie (oui à 21h00 dans un service, pour transporter une patiente au scanner, on a plus vite fait de le faire soi-même que d’appeler un brancardier déjà débordé par le service des urgences) que je remarque les sourires sur les visages des membres de l’équipe soignante.
Peu importe. Je descends Jacqueline au scanner. Accompagné d’une infirmière qui me dit « Tu es adorable, je te laisse faire ».
—
Jacqueline est morte paisiblement cinq jours plus tard.
J’ai réalisé, bien après, que ce scanner était totalement inutile … et que toute l’équipe le savait.
Ils savaient que Jacqueline allait mourir bientôt ; ils ont vu ça si souvent.
Mais pour moi, c’était la première fois.
Ils n’ont pas osé me contredire.
Ils ont préféré me laisser réaliser par moi-même l’absurdité de ma démarche.
Mon dévouement les a peut-être touché aussi.
Je les remercie de m’avoir laissé faire. Je devais en avoir besoin.
C’est comme cela qu’on apprend, parait-il.
—
Quand j’étais simple externe, j’ai vu des patients mourir, mais je ne faisais que les suivre de loin. Je n’en avais pas la responsabilité.
Ce n’est pas facile de laisser partir une de ses premières patientes rien qu’à soi, sans rien faire. Et pourtant, parfois c’est ce que l’on doit faire.
Quand il n’y a plus rien à faire, à part soulager.
Une de mes toutes premières vraies patientes à moi, rien qu’à moi, s’appelait Jacqueline.
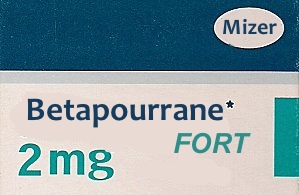
Le vrai nom du médicament a été remplacé par un de mon invention, le « Betapourrane Fort »
Je suis alors interne aux urgences.
Je me destine déjà à l’exercice de la médecine générale en cabinet de ville. Mais je dois faire encore quelques stages à l’hôpital avant de finir mes études.
Cela fait un mois que je suis dans ce service.
Je suis satisfait de ce stage, l’ambiance est sympathique, mes chefs sont jeunes. Certains sont même des amis que je croise souvent à la Faculté (ils sont dans une promotion un ou deux ans avant la mienne)
Je m’y sens bien. Le service est dans un petit hôpital de périphérie d’une grande ville.
Il y a beaucoup de travail, mais j’ai connu pire pendant mes gardes d’externe au CHU.
Voilà pour planter le décor.
Un jour, le chef de service nous réunit tous pour nous apprendre une grande nouvelle.
Une jeune et jolie jeune femme est à coté de lui.
Je pense déjà : oh c’est sympa, il nous présente sa fille ? Sa maitresse ? Sa femme ? Une nouvelle interne ? Ah non, elle est en tailleur, décolleté, talons hauts et brushing parfait. Elle n’a pas le look de quelqu’un qui passe ses journées à examiner des malades en blouse blanche.
Non, rien de tout cela.
Avec un grand sourire, le Chef nous annonce fièrement que nous devons, à partir de maintenant, quand il nous faut prescrire un anti-inflammatoire, toujours inscrire sur nos ordonnances le Betapourrane Fort. C’est important. Car la gentille représentante du laboratoire, à coté de lui, a promis des cadeaux et de l’argent pour le service, comprenez : pour la gueule du chef de service.
Tout le monde a l’air de trouver ça merveilleux autour de moi.
Le Betapourrane Fort, je n’en prescris jamais. Et pour cause, ce n’est pas un très bon anti-inflammatoire, il ne marche pas mieux que les autres, mais il a beaucoup d’effets secondaires potentiellement graves.
Je sors de la salle de réunion.
J’ai la nausée.
—
Je suis en stage chez le praticien (stage chez un généraliste de ville)
Je suis seul aux commandes ce matin.
Rah, la secrétaire a oublié de décommander M. LaboPourri.
Tant pis, je lui accorde 5 minutes.
Il est très jeune, il est nouveau dans la profession de visiteur médical (VM)
Il me présente un nouveau médicament (qui ne se « vend » pas bien), en récitant bien sa leçon.
Je sais qu’il fait un métier difficile et ingrat.
J’attends patiemment qu’il termine son discours, que je n’ai écouté, comme à mon habitude, que d’une oreille distraite. Je lui demande alors, non sans une certaine dose de malice, s’il trouve son nouveau métier intéressant.
Il me répond, et je vous jure que c’est exactement ce qu’il m’a dit :
« Je pensais au départ que mon métier servait à informer honnêtement les médecins sur les médicaments, leurs indications, leurs contre-indications et leurs effets indésirables. Franchement, je suis un peu déçu »
—
Je suis jeune remplaçant dans le cabinet de celui qui sera, je ne le sais pas encore, mon futur associé.
Il est installé depuis 20 ans, il reçoit, comme beaucoup d’autres médecins, les « Visiteuses médicales ».
Chez lui, c’est trois fois par semaine à 9h00 pile.
Aujourd’hui je le remplace, Il n’a pas annulé le rendez-vous. Il sait pourtant que je n’aime pas ça.
Mme GrosPharma vient me présenter le Superlox, un antibiotique qu’elle dit qu’il est beaucoup mieux que les autres, mais aussi deux autres médicaments qu’elle présente à chaque fois.
Nous nous sommes déjà rencontrés dans un autre cabinet, elle m’a déjà présenté le Superlox quelques mois avant.
Nous en avons déjà discuté, pour moi le Superlox, c’est de la merde c’est un médicament à ne pas prescrire. Un antibiotique qui ne marche pas mieux que les autres mais avec des effets secondaires cardiaques graves.
Elle met en doute, purement et simplement, mes affirmations, en insistant par la même occasion sur le fait que le comprimé est facile à avaler, une seule fois par jour.
Je sais bien qu’elle me ment. J’ai la Revue Prescrire sous les yeux avec les références bibliographiques des études qui prouvent ce que j’affirme.
Elle vend son produit, comme un commercial de supermarché. C’est son boulot.
Je n’insiste pas, c’est peine perdue.
Elle me parle ensuite de ses deux autres médicaments.
Je l’arrête brutalement dans son élan : « Mais vous ne pouvez pas me présenter autre chose que ces deux médicaments ? »
Et là, elle me répond, la peur dans son regard : « Ah mais non ! Cela fait 15 ans que je présente ces deux médicaments, je ne vais pas changer maintenant ! »
—
Je n’ai plus jamais reçu de VM, en remplacement ou ailleurs.
Je lis la Revue Prescrire, je me forme de façon indépendante.
Ceci est le premier billet de mon blog.
Je m’appelle Dr Stéphane
Bonjour