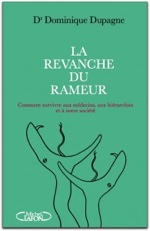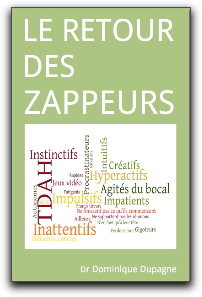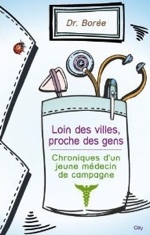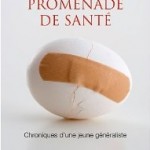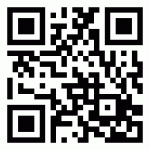Catégorie : #PrivésDeDeserts
 J’ai eu envie d’arrêter médecine, vraiment.
J’ai eu envie d’arrêter médecine, vraiment.
Passer mes journées à apprendre bêtement mes cours pour les recracher le plus fidèlement possible.
Penser « points à l’Internat » plutôt que « utile pour ma future pratique »
J’ai eu envie d’arrêter médecine, vraiment.
Cette médecine des hôpitaux, c’est là où nous sommes sensés tout apprendre, si souvent protocolisée à l’extrême, peu respectueuse des patients, infantilisante, écrasante, méprisante parfois. Déshumanisée.
Je n’ai connu que ça jusqu’à l’internat.
J’ai eu envie d’arrêter médecine, vraiment.
D’abord externe, secrétaire de luxe passant mes matinées à ranger, classer, faire des trous dans des feuilles de résultats biologiques pour les mettre dans des classeurs.
Éplucher, le plus souvent seul, les dossiers des entrants. Examiner encore seul les patients, leur poser des questions.
Voir ses chefs se battre pour devenir Calife à la place du Calife, lécher les botes de leurs supérieurs, y perdre leur âme parfois.
Avoir pour seule perspective d’avenir que de suivre ce modèle, à l’hôpital.
J’ai eu envie d’arrêter médecine, vraiment.
Et en toile de fond, sournoisement, tout au long des études, cette idée nauséabonde qu’en dehors des spécialités, qu’en dehors de l’hôpital, on ne peut pas faire de la bonne médecine.
J’y ai même cru, putain.
Jusque dans les cas cliniques que l’on nous proposait pour tester nos connaissances, il y avait toujours le généraliste-qui-a-fait-une-bêtise, qui s’est trompé de diagnostic, qui a prescrit le mauvais médicament. Des questions de type « Que pensez vous de la prise en charge du médecin traitant ? » aux réponses obligatoires du genre « Il a fait n’importe quoi ».
Il y avait aussi quelques Grands Professeurs Spécialistes qui ne trouvaient rien de mieux, pour nous « motiver » que de nous dire :
« Si vous continuez comme ça vous allez finir généraliste ! » (et je ne suis pas le seul à le dire)
J’ai eu envie d’arrêter médecine, vraiment.
Je n’ai pas été suffisamment bien classé au concours de l’internat pour faire autre chose que de la médecine générale.
Et j’ai eu envie d’arrêter médecine, vraiment.
Devenir interne, pour n’avoir que plus de responsabilités, (j’ai heureusement beaucoup appris par moi-même) Faire tourner les services.
Devoir se battre, faire grève (j’en étais) pour imposer dans la loi le repos de sécurité après une garde. (Le repos après 24h de travail non-stop) Et voir bien des années plus tard, les internes se battre à nouveau pour son application systématique.
J’ai eu envie d’arrêter médecine, vraiment.
Et enfin, en 7eme année (en 7eme année putain), découvrir la médecine générale.
La découvrir vraiment, en stage dans un cabinet de généraliste.
Dés les premières jours réaliser la chance qui a été la mienne de rater le concours.
Découvrir une médecine de qualité (en tout cas, qui n’a rien à voir avec les horreurs que l’on a toujours voulu me faire croire à l’hôpital … )
Oui, de qualité, car il m’a fallu attendre tout ce temps pour qu’un maître de stage, généraliste libéral, commence à me parler d’EBM, qu’il me fasse découvrir la Revue Prescrire.
Au contact de mes maîtres de stage, j’ai appris à ne pas prescrire sans réfléchir, en particulier des médicaments dangereux utilisés par beaucoup et depuis retirés du marché.
J’ai appris à ne pas recevoir les visiteurs médicaux, et à me former de façon indépendante.
J’ai appris à découvrir une médecine proche des gens, loin de tout ce qui m’avait profondément déplu à l’hôpital.
Et tellement d’autres choses.
Et tellement d’autres gens.
Je ne regrette pas d’avoir fait médecine.
Mais comme je le disais l’autre jour à Marisol,
j’ai failli tout arrêter, vraiment.
Faute d’avoir rencontré plus tôt la médecine générale.
Et ça aurait été vraiment dommage.
Médecine Générale 2.0
Les propositions des médecins généralistes blogueurs pour faire renaître la médecine générale

Comment sauver la médecine générale en France et assurer des soins primaires de qualité répartis sur le territoire ? Chacun semble avoir un avis sur ce sujet, d’autant plus tranché qu’il est éloigné des réalités du terrain.
Nous, médecins généralistes blogueurs, acteurs d’un « monde de la santé 2.0 », nous nous reconnaissons mal dans les positions émanant des diverses structures officielles qui, bien souvent, se contentent de défendre leur pré carré et s’arc-boutent sur les ordres établis.
A l’heure où les discussions concernant l’avenir de la médecine générale font la une des médias, nous avons souhaité prendre position et constituer une force de proposition.
Conscients des enjeux et des impératifs qui sont devant nous, héritages d’erreurs passées, nous ne souhaitons pas nous dérober à nos responsabilités. Pas plus que nous ne souhaitons laisser le monopole de la parole à d’autres.
Notre ambition est de délivrer à nos patients des soins primaires de qualité, dans le respect de l’éthique qui doit guider notre exercice, et au meilleur coût pour les budgets sociaux. Nous souhaitons faire du bon travail, continuer à aimer notre métier, et surtout le faire aimer aux générations futures de médecins pour lui permettre de perdurer.
Nous pensons que c’est possible.
Sortir du modèle centré sur l’hôpital
La réforme de 1958 a lancé l’hôpital universitaire moderne. C’était une bonne chose qui a permis à la médecine française d’atteindre l’excellence, reconnue internationalement.
Pour autant, l’exercice libéral s’est trouvé marginalisé, privé d’enseignants, coupé des étudiants en médecine. En 50 ans, l’idée que l’hôpital doit être le lieu quasi unique de l’enseignement médical s’est ancrée dans les esprits. Les universitaires en poste actuellement n’ont pas connu d’autre environnement.
L’exercice hospitalier et salarié est ainsi devenu une norme, un modèle unique pour les étudiants en médecine, conduisant les nouvelles promotions de diplômés à délaisser de plus en plus l’exercice libéral qu’ils n’ont jamais rencontré pendant leurs études.
C’est une profonde anomalie qui explique en grande partie nos difficultés actuelles.
Cet hospitalo-centrisme a eu d’autres conséquences dramatiques :
– Les médecins généralistes (MG) n’étant pas présents à l’hôpital n’ont eu accès que tout récemment et très partiellement à la formation des étudiants destinés à leur succéder.
– Les budgets universitaires dédiés à la MG sont ridicules en regard des effectifs à former.
– Lors des négociations conventionnelles successives depuis 1989, les spécialistes formés à l’hôpital ont obtenu l’accès exclusif aux dépassements d’honoraires créés en 1980, au détriment des généralistes contraints de se contenter d’honoraires conventionnels bloqués.
Pour casser cette dynamique mortifère pour la médecine générale, il nous semble nécessaire de réformer profondément la formation initiale des étudiants en médecine.
Cette réforme aura un double effet :
– Rendre ses lettres de noblesse à la médecine « de ville » et attirer les étudiants vers ce mode d’exercice.
– Apporter des effectifs importants de médecins immédiatement opérationnels dans les zones sous-médicalisées.
Il n’est pas question dans ces propositions de mesures coercitives aussi injustes qu’inapplicables contraignant de jeunes médecins à s’installer dans des secteurs déterminés par une tutelle sanitaire.
Nous faisons l’analyse que toute mesure visant à obliger les jeunes MG à s’installer en zone déficitaire aurait un effet majeur de repoussoir. Elle ne ferait qu’accentuer la désaffection pour la médecine générale, poussant les jeunes générations vers des offres salariées (nombreuses), voire vers un exercice à l’étranger.
C’est au contraire une véritable réflexion sur l’avenir de notre système de santé solidaire que nous souhaitons mener. Il s’agit d’un rattrapage accéléré d’erreurs considérables commises avec la complicité passive de confrères plus âgés, dont certains voudraient désormais en faire payer le prix aux jeunes générations.
Idées-forces
Les idées qui sous-tendent notre proposition sont résumées ci-dessous, elles seront détaillées ensuite.
Elles sont applicables rapidement.
1) Construction par les collectivités locales ou les ARS de 1000 maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) qui deviennent aussi des maisons médicales de garde pour la permanence des soins, en étroite collaboration avec les professionnels de santé locaux.
2) Décentralisation universitaire qui rééquilibre la ville par rapport à l’hôpital : les MSP se voient attribuer un statut universitaire et hébergent des externes, des internes et des chefs de clinique. Elles deviennent des MUSt : Maisons Universitaires de Santé qui constituent l’équivalent du CHU pour la médecine de ville.
3) Attractivité de ces MUSt pour les médecins seniors qui acceptent de s’y installer et d’y enseigner : statut d’enseignant universitaire avec rémunération spécifique fondée sur une part salariée majoritaire et une part proportionnelle à l’activité.
4) Création d’un nouveau métier de la santé : “Agent de gestion et d’interfaçage de MUSt” (AGI). Ces agents polyvalents assurent la gestion de la MUSt, les rapports avec les ARS et l’Université, la facturation des actes et les tiers payants. De façon générale, les AGI gèrent toute l’activité administrative liée aux MUSt et à son activité de soin. Ce métier est distinct de celui de la secrétaire médicale de la MUSt.
1) 1000 Maisons Universitaires de Santé
–
Le chiffre paraît énorme, et pourtant… Dans le cadre d’un appel d’offres national, le coût unitaire d’une MUSt ne dépassera pas le million d’euros (1000 m2. Coût 900 €/m2)
Le foncier sera fourni gratuitement par les communes ou les intercommunalités mises en compétition pour recevoir la MUSt. Il leur sera d’ailleurs demandé en sus de fournir des logements à prix très réduit pour les étudiants en stage dans la MUSt. Certains centres de santé municipaux déficitaires pourront être convertis en MUSt.
Au final, la construction de ces 1000 MUSt ne devrait pas coûter plus cher que la vaccination antigrippale de 2009 ou 5 ans de prescriptions de médicaments (inutiles) contre la maladie d’Alzheimer. C’est donc possible, pour ne pas dire facile.
Une MUSt est appelée à recevoir des médecins généralistes et des paramédicaux. La surface non utilisée par l’activité de soin universitaire peut être louée à d’autres professions de santé qui ne font pas partie administrativement de la MUSt (autres médecins spécialistes, dentiste, laboratoire d’analyse, cabinet de radiologie…). Ces MUSt deviennent de véritables pôles de santé urbains et ruraux.
Le concept de MUSt fait déjà l’objet d’expérimentations, dans le 94 notamment, il n’y a donc rien d’utopique.
2) L’université dans la ville
–
Le personnel médical qui fera fonctionner ces MUSt sera constitué en grande partie d’internes et de médecins en post-internat :
· Des internes en médecine générale pour deux de leurs semestres qu’ils passaient jusqu’ici à l’hôpital. Leur cursus comportera donc 2 semestres en MUSt, 1 semestre chez le praticien et 3 semestres hospitaliers. Ils seront rémunérés par l’ARS, subrogée dans le paiement des honoraires facturés aux patients qui permettront de couvrir une partie de leur rémunération. Le coût global de ces internes pour les ARS sera donc très inférieur à leur coût hospitalier du fait des honoraires perçus.
· De chefs de clinique universitaire de médecine générale (CCUMG), postes à créer en nombre pour rattraper le retard pris sur les autres spécialités. Le plus simple est d’attribuer proportionnellement à la médecine générale autant de postes de CCU ou assimilés qu’aux autres spécialités (un poste pour deux internes), soit un minimum de 3000 postes (1500 postes renouvelés chaque année). La durée de ce clinicat est de deux ans, ce qui garantira la présence d’au moins deux CCUMG par MUSt. Comme les autres chefs de clinique, ces CCUMG sont rémunérés à la fois par l’éducation nationale (part enseignante) et par l’ARS, qui reçoit en retour les honoraires liés aux soins délivrés. Ils bénéficient des mêmes rémunérations moyennes, prérogatives et avantages que les CCU hospitaliers.
Il pourrait être souhaitable que leur revenu comprenne une base salariée majoritaire, mais aussi une part variable dépendant de l’activité (par exemple, 20 % du montant des actes pratiqués) comme cela se pratique dans de nombreux dispensaires avec un impact significatif sur la productivité des consultants.
· Des externes pour leur premier stage de DCEM3, tel que prévu par les textes et non appliqué faute de structure d’accueil. Leur modeste rémunération sera versée par l’ARS. Ils ne peuvent pas facturer d’actes mais participent à l’activité et à la productivité des internes et des CCUMG.
· De médecins seniors au statut mixte : les MG libéro-universitaires. Ils ont le choix d’être rémunérés par l’ARS, subrogée dans la perception de leurs honoraires (avec une part variable liée à l’activité) ou de fonctionner comme des libéraux exclusifs pour leur activité de soin. Une deuxième rémunération universitaire s’ajoute à la précédente, liée à leur fonction d’encadrement et d’enseignement. Du fait de l’importance de la présence de ces CCUMG pour lutter contre les déserts médicaux, leur rémunération universitaire pourra être financée par des budgets extérieurs à l’éducation nationale ou par des compensations entre ministères.
Au-delà de la nouveauté que représentent les MUSt, il nous paraît nécessaire, sur le long terme, de repenser l’organisation du cursus des études médicales sur un plan géographique en favorisant au maximum la décentralisation hors CHU, aussi bien des stages que des enseignements.
En effet, comment ne pas comprendre qu’un jeune médecin qui a passé une dizaine d’années dans sa ville de faculté et y a construit une vie familiale et amicale ne souhaite pas bien souvent y rester ?
Une telle organisation existe déjà, par exemple, pour les écoles infirmières, garantissant une couverture assez harmonieuse de tout le territoire par cette profession, et les nouvelles technologies permettent d’ores et déjà, de manière simple et peu onéreuse, cette décentralisation pour tous les enseignements théoriques.
3) Incitation plutôt que coercition : des salaires aux enchères
–
Le choix de la MUSt pour le bref stage de ville obligatoire des DCEM3 se fait par ordre alphabétique avec tirage au sort du premier à choisir, c’est la seule affectation qui présente une composante coercitive.
Le choix de la MUSt pour les chefs de clinique et les internes se pratique sur le principe de l’enchère : au salaire de base égal au SMIC est ajouté une prime annuelle qui sert de régulateur de choix : la prime augmente à partir de zéro jusqu’à ce qu’un(e) candidat(e) se manifeste. Pour les MUSt “difficiles”, la prime peut atteindre un montant important car elle n’est pas limitée. Par rapport à la rémunération actuelle d’un CCU (45 000 €/an), nous faisons le pari que la rémunération globale moyenne n’excédera pas ce montant.
En cas de candidats multiples pour une prime à zéro (et donc une rémunération de base au SMIC pour les MUSt les plus attractives) un tirage au sort départage les candidats.
Ce système un peu complexe présente l’énorme avantage de ne créer aucune frustration puisque chacun choisit son poste en mettant en balance la pénibilité et la rémunération.
De plus, il permet d’avoir la garantie que tous les postes seront pourvus.
Ce n’est jamais que la reproduction du fonctionnement habituel du marché du travail : l’employeur augmente le salaire pour un poste donné jusqu’à trouver un candidat ayant le profil requis et acceptant la rémunération. La différence est qu’il s’agit là de fonctions temporaires (6 mois pour les internes, 2 ans pour les chefs de clinique) justifiant d’intégrer cette rémunération variable sous forme de prime.
Avec un tel dispositif, ce sont 6 000 médecins généralistes qui seront disponibles en permanence dans les zones sous-médicalisées : 3000 CCUMG et 3000 internes de médecine générale.
4) Un nouveau métier de la santé : AGI de MUSt
–
Les MUSt fonctionnent bien sûr avec une ou deux secrétaires médicales suivant leur effectif médical et paramédical.
Mais la nouveauté que nous proposons est la création d’un nouveau métier : Agent de Gestion et d’Interfaçage (AGI) de MUSt. Il s’agit d’un condensé des fonctions remplies à l’hôpital par les agents administratifs et les cadres de santé hospitaliers.
C’est une véritable fonction de cadre supérieur de santé qui comporte les missions suivantes au sein de la MUSt :
– Gestion administrative et technique (achats, coordination des dépenses…).
– Gestion des ressources humaines.
– Interfaçage avec les tutelles universitaires
– Interfaçage avec l’ARS, la mairie et le Conseil Régional.
– Gestion des locaux loués à d’autres professionnels.
Si cette nouvelle fonction se développe initialement au sein des MUSt, il sera possible ensuite de la généraliser aux cabinets de groupes ou maisons de santé non universitaires, et de proposer des solutions mutualisées pour tous les médecins qui le souhaiteront.
Cette délégation de tâches administratives est en effet indispensable afin de permettre aux MG de se concentrer sur leurs tâches réellement médicales : là où un généraliste anglais embauche en moyenne 2,5 équivalents temps-plein, le généraliste français en est à une ½ secrétaire. Et encore, ce gain qualitatif représente-t-il parfois un réel sacrifice financier.
Directement ou indirectement, il s’agit donc de nous donner les moyens de travailler correctement sans nous disperser dans des tâches administratives ou de secrétariat.
Une formule innovante : les “chèques-emplois médecin”
–
Une solution complémentaire à l’AGI pourrait résider dans la création de « chèques-emploi » financés à parts égales par les médecins volontaires et par les caisses. [1]
Il s’agit d’un moyen de paiement simplifié de prestataires de services (AGI, secrétaires, personnel d’entretien) employés par les cabinets de médecins libéraux, équivalent du chèque-emploi pour les familles.
Il libérerait des tâches administratives les médecins isolés qui y passent un temps considérable, sans les contraindre à se transformer en employeur, statut qui repousse beaucoup de jeunes médecins.
Cette solution stimulerait l’emploi dans les déserts médicaux et pourrait donc bénéficier de subventions spécifiques. Le chèque-emploi servirait ainsi directement à une amélioration qualitative des soins et à dégager du temps médical pour mieux servir la population.
Il est beaucoup question de “délégation de tâche” actuellement. Or ce ne sont pas les soins aux patients que les médecins souhaitent déléguer pour améliorer leur disponibilité : ce sont les contraintes administratives ! Former des agents administratif est bien plus simple et rapide que de former des infirmières, professionnelles de santé qualifiées qui sont tout autant nécessaires et débordées que les médecins dans les déserts médicaux.
Aspects financiers : un budget très raisonnable
Nous avons vu que la construction de 1000 MUSt coûtera moins cher que 5 ans de médicaments anti-Alzheimer ou qu’une vaccination antigrippale comme celle engagée contre la pandémie de 2009.
Les internes étaient rémunérés par l’hôpital, ils le seront par l’ARS. Les honoraires générés par leur activité de ville devraient compenser les frais que l’hôpital devra engager pour les remplacer par des FFI, permettant une opération neutre sur le plan financier, comme ce sera le cas pour les externes.
La rémunération des chefs de clinique constitue un coût supplémentaire, à la mesure de l’enjeu de cette réforme. Il s’agit d’un simple rattrapage du retard pris dans les nominations de CCUMG chez les MG part rapport aux autres spécialités. De plus, la production d’honoraires par les CCUMG compensera en partie leurs coûts salariaux. La dépense universitaire pour ces 3000 postes est de l’ordre de 100 millions d’euros par an, soit 0,06 % des dépenses de santé françaises. À titre de comparaison, le plan Alzheimer 2008-2012 a été doté d’un budget de 1,6 milliards d’euros. Il nous semble que le retour des médecins dans les campagnes est un objectif sanitaire qui justifie lui aussi un “Plan” et non des mesures hâtives dépourvues de vision à long terme.
N’oublions pas non plus qu’une médecine de qualité dans un environnement universitaire est réputée moins coûteuse, notamment en prescriptions médicamenteuses. Or, un médecin “coûte” à l’assurance-maladie le double de ses honoraires en médicaments. Si ces CCUMG prescrivent ne serait-ce que 20% moins que la moyenne des autres prescripteurs, c’est 40% de leur salaire qui est économisé par l’assurance-maladie.
Les secrétaires médicales seront rémunérées en partie par la masse d’honoraires générée, y compris par les « libéro-universitaires », en partie par la commune ou l’intercommunalité candidate à l’implantation d’une MUSt.
Le reclassement des visiteurs médicaux
–
Le poste d’Agent de Gestion et d’Interfaçage (AGI) de MUSt constitue le seul budget significatif créé par cette réforme. Nous avons une proposition originale à ce sujet. Il existe actuellement en France plusieurs milliers de visiteurs médicaux assurant la promotion des médicaments auprès des prescripteurs. Nous savons que cette promotion est responsable de surcoûts importants pour l’assurance-maladie. Une solution originale consisterait à interdire cette activité promotionnelle et à utiliser ce vivier de ressources humaines libérées pour créer les AGI.
En effet, le devenir de ces personnels constitue l’un des freins majeurs opposés à la suppression de la visite médicale. Objection recevable ne serait-ce que sur le plan humain. Ces personnels sont déjà répartis sur le territoire, connaissent bien l’exercice médical et les médecins. Une formation supplémentaire de un an leur permettrait d’exercer cette nouvelle fonction plus prestigieuse que leur ancienne activité commerciale.
Dans la mesure où leurs salaires (industriels) étaient forcément inférieurs aux prescriptions induites par leurs passages répétés chez les médecins, il n’est pas absurde de penser que l’économie induite pour l’assurance-maladie et les mutuelles sera supérieure au coût global de ces nouveaux agents administratifs de ville.
Il s’agirait donc d’une solution réaliste, humainement responsable et économiquement neutre pour l’assurance maladie.
Globalement, cette réforme est donc peu coûteuse. Nous pensons qu’elle pourrait même générer une économie globale, tout en apportant plusieurs milliers de soignants immédiatement opérationnels là où le besoin en est le plus criant.
De toute façon, les autres mesures envisagées sont soit plus coûteuses (fonctionnarisation des médecins libéraux) soit irréalisables (implanter durablement des jeunes médecins là où il n’y a plus d’école, de poste, ni de commerces). Ce n’est certainement pas en maltraitant davantage une profession déjà extraordinairement fragilisée qu’il sera possible d’inverser les tendances actuelles.
Calendrier
La réforme doit être mise en place avec “agilité”. Le principe sera testé dans des MUSt expérimentales et modifié en fonction des difficultés rencontrées. L’objectif est une généralisation en 3 ans.
Ce délai permettra aux étudiants de savoir où ils s’engagent lors de leur choix de spécialité. Il permettra également de recruter et former les maîtres de stage libéro-universitaires ; il permettra enfin aux ex visiteurs médicaux de se former à leurs nouvelles fonctions.
Et quoi d’autre ?
Dans ce document, déjà bien long, nous avons souhaité cibler des propositions simples et originales. Nous n’avons pas voulu l’alourdir en reprenant de nombreuses autres propositions déjà exprimées ailleurs ou qui nous paraissent dorénavant des évidences, par exemple :
• L’indépendance de notre formation initiale et continue vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique ou de tout autre intérêt particulier.
• La nécessité d’assurer une protection sociale satisfaisante des médecins (maternité, accidents du travail…).
• La nécessaire diversification des modes de rémunération. Si nous ne rejetons pas forcément le principe du paiement à l’acte – qui a ses propres avantages – il ne nous semble plus pouvoir constituer le seul socle de notre rémunération. Il s’agit donc de :
– Augmenter la part de revenus forfaitaires, actuellement marginale.
– Ouvrir la possibilité de systèmes de rémunération mixtes associant capitation et paiement à l’acte ou salariat et paiement à l’acte.
– Surtout, inventer un cadre flexible, car nous pensons qu’il devrait être possible d’exercer la « médecine de famille » ambulatoire en choisissant son mode de rémunération.
• La fin de la logique mortifère de la rémunération à la performance fondée sur d’hypothétiques critères « objectifs », constat déjà fait par d’autres pays qui ont tenté ces expériences. En revanche, il est possible d’inventer une évaluation qualitative intelligente à condition de faire preuve de courage et d’imagination.
• La nécessité de viser globalement une revalorisation des revenus des généralistes français qui sont aujourd’hui au bas de l’échelle des revenus parmi les médecins français mais aussi en comparaison des autres médecins généralistes européens. D’autres pays l’ont compris : Lorsque les généralistes sont mieux rémunérés et ont les moyens de travailler convenablement, les dépenses globales de santé baissent !
Riches de notre diversité d’âges, d’origines géographiques ou de mode d’exercice, et partageant pourtant la même vision des fondamentaux de notre métier, notre communauté informelle est prête à prendre part aux débats à venir.
Dotés de nos propres outils de communication (blogs, forums, listes de diffusion et d’échanges, réseaux sociaux), nous ambitionnons de contribuer à la fondation d’une médecine générale 2.0.
Liste des 24 médecins généralistes blogueurs signataires de ce texte
(certains confrères qui ont participé au débat n’y figurent pas) :
AliceRedSparrow – Borée – Bruit des sabots – Christian Lehmann – Doc Maman – Doc Souristine – Doc Bulle – Docteur Milie – Docteur V – Dominique Dupagne – Dr Couine – Dr Foulard – Dr Sachs Jr – Dr Stéphane – Dzb17 – Euphraise – Farfadoc – Fluorette – Gélule – Genou des Alpages – Granadille – Jaddo – Matthieu Calafiore – Yem
NOTES
[1] A titre d’exemple, pour 100 patients enregistrés, la caisse abonderait l’équivalent de 2 ou 2,5 heures d’emploi hebdomadaire et le médecin aurait la possibilité de prendre ces chèques-emploi en payant une somme équivalente (pour arriver à un temps plein sur une patientèle type de 800 patients).
Vous pouvez télécharger ces propositions au format PDF. 
Pour soutenir ces propositions,
je vous invite à y associer votre nom en signant la pétition
sur le site atoute.org en bas de cette page.
EDIT du 04/09/2012
Au lendemain du buzz qu’a suscité la publication de ce texte, Dominique Dupagne fait une brève et utile mise au point « #PrivésDeDéserts Le buzz, et après ? ».