
Jacqueline est une petite dame blonde d’une cinquantaine d’années que je rencontre pendant les premières semaines de mon internat.
C’est l’une de mes toutes premières patientes dont j’ai la responsabilité pendant mon stage en Pneumologie. En fait, l’une des toutes premières patientes que je gère seul, avec les conseils avisés de mes chefs, mais seul.
Jacqueline n’est pas dans ce service pour rien.
Elle a un cancer du poumon. Le genre de cancer qu’elle a attrapé en fumant ses deux paquets de clopes par jour depuis ses 14 ans.
Elle vient régulièrement dans le service, pour ses séances de chimiothérapie et pour des bilans intermédiaires pour faire le point sur l’évolution de sa maladie.
Je l’aime bien Jacqueline. Elle m’est sympathique. On se voit tous les matins pendant son hospitalisation, pendant la « visite », on discute beaucoup, elle en a besoin.
Médicalement parlant, elle m’a tout fait Jacqueline.
La crise de panique dans le scanner.
L’aplasie fébrile post chimiothérapie.
La transfusion de plaquettes en urgences à 1h30 du matin (alors que j’étais de garde), avec son corollaire, le coup de téléphone à l’ophtalmo au milieu de la nuit pour vérifier que, oui oui oui elle saigne bien dans son oeil à cause de son manque de plaquette (Pardon gentil ophtalmo de t’avoir réveillé)
Le dossier d’assurance de dix pages détaillées à remplir en me demandant de pas trop insister sur son cancer. (Elle est gentille Jacqueline.)
La présentation de son dossier au staff devant un très grand professeur pour essayer de tenter un début de changement dans sa prise en charge.
Bref, je m’investis beaucoup dans la santé de Jacqueline.
Mais Jacqueline ne se rend pas bien compte qu’elle va bientôt mourir
Et moi je le sais, mais je ne veux pas y penser.
—
Un jour, je suis appelé au chevet de Jacqueline. Elle n’a pas fait de chimiothérapie récemment mais elle a de la fièvre et de forts maux de tête.
Elle a beaucoup maigri.
Il est 21h00 et je dois rentrer chez moi. Mais je n’ai pas envie de laisser le problème au médecin de garde.
J’essaie de faire au mieux. Je panique un peu, je n’ai pas envie de la laisser tomber.
Je lui prescris un peu plus de morphine pour la soulager et je lui demande un scanner cérébral en urgence, pour essayer de comprendre ce qui se passe. La négociation avec le radiologue de garde est difficile, mais j’arrive finalement à le convaincre.
Au moment où je dis aux infirmières que je descends Jacqueline dans le service de radiologie (oui à 21h00 dans un service, pour transporter une patiente au scanner, on a plus vite fait de le faire soi-même que d’appeler un brancardier déjà débordé par le service des urgences) que je remarque les sourires sur les visages des membres de l’équipe soignante.
Peu importe. Je descends Jacqueline au scanner. Accompagné d’une infirmière qui me dit « Tu es adorable, je te laisse faire ».
—
Jacqueline est morte paisiblement cinq jours plus tard.
J’ai réalisé, bien après, que ce scanner était totalement inutile … et que toute l’équipe le savait.
Ils savaient que Jacqueline allait mourir bientôt ; ils ont vu ça si souvent.
Mais pour moi, c’était la première fois.
Ils n’ont pas osé me contredire.
Ils ont préféré me laisser réaliser par moi-même l’absurdité de ma démarche.
Mon dévouement les a peut-être touché aussi.
Je les remercie de m’avoir laissé faire. Je devais en avoir besoin.
C’est comme cela qu’on apprend, parait-il.
—
Quand j’étais simple externe, j’ai vu des patients mourir, mais je ne faisais que les suivre de loin. Je n’en avais pas la responsabilité.
Ce n’est pas facile de laisser partir une de ses premières patientes rien qu’à soi, sans rien faire. Et pourtant, parfois c’est ce que l’on doit faire.
Quand il n’y a plus rien à faire, à part soulager.
Une de mes toutes premières vraies patientes à moi, rien qu’à moi, s’appelait Jacqueline.




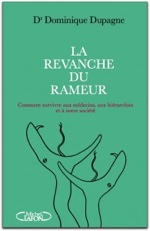
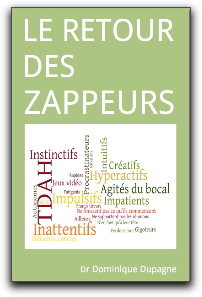


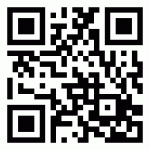

15 Commentaires